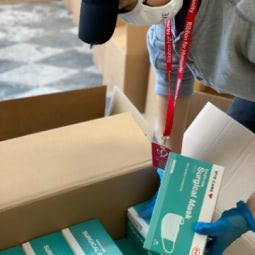Conférence:
Le Système Social Bassa Mpô’o Bati Aujourd’hui et Demain ou de L’Acéphalisme Mémoriel à la Figure Pyramidale Imposée, par Gaston KELMAN et l’Honorable Cabral LIBII LI NGUÉ
Date: Vendredi 31 Mai 2024 à partir de 18h 30 precises
Adresse: Jane E. Lawton Community Center
4301 Willow Lane, Chevy Chase , MD 20815
EN GUISE DE PROLEGOMÈNES
Ma lecture de la renaissance bassa-mpoo-bati s’inscrit dans deux citations de l’histoire
de Rome. L’une trace le destin du peuple bassa-mpoo-bati, le peuple de Mpodol. L’autre
l’avertit de la difficulté à accomplir sa mission, à réaliser son destin.
Tu, regere imperio populos, (Romane) Bassa-Mpoo-Bati memento (Rappelle-toi
peuple bassa, que tu dois diriger le monde).
Sans prétention, sans chauvinisme et encore moins tribalisme, j’avance l’hypothèse – je pourrais parler de thèse et même de réalité – que l’histoire du peuple bassa-mpoo-bati, sa culture mémorielle l’inscrivent dans le destin de peuple leader. Mpodol Ruben Um Nyobè en est l’illustration contemporaine. C’est lui qui sonne le départ de la renaissance du Cameroun et de celle du peuple bassa. C’est l’homme qui par sa hauteur et s on intelligence a exaspéré le colonialisme français au point de le pousser dans la barbarie d’une guerre asymétrique, la seule guerre de décolonisation négro-africaine. Bien entendu, l’ambition du bassa-mpoo-bati n’est pas de diriger le monde. L’ambition n’est même pas de diriger un monde que serait le Cameroun. Il s’agit de démontrer que la spécificité de ce peuple le prédispose à être en tête de l’invention de la nouvelle identité camerounaise qui doit émerger au bout de cette renaissance. Les autres peuples ont bien entendu des compétences en tout genre, intellectuelles, matérielles, tactiques.
Tantae molis erat (romanam) Bassa-Mpoo-Bati condere gentem (Tant elle était
difficile à conduire la renaissance du peuple BMB)
Et pourtant, tout laisse à penser que plus que tout autre peuple camerounais, le BMB est le groupe le moins à l’aise dans la nouvelle nation. Ce qui est vrai tout aussi dans une perspective historique que mémorielle. Son éparpillement géographique dans quatre régions, sa stigmatisation par le colon, tout ceci avait justement pour but de le punir de sa clairvoyance, du projet de désaliénation que Mpodol portait. Aussi étrange que cela puisse paraître, les héritiers idéologiques de la colonisation conservent cette défiance envers le peuple de Mpodol et l’idée d’une grande Sanaga maritime apparaît comme inconcevable. Si on ajoute à ce facteur exogène le modèle mémoriel de l’acéphalisme, facteur endogène, le BMB semble mal parti dans cet univers dont la totalité des autres composantes viennent de systèmes pyramidaux, avec cette autorité temporelle que le BMB ne connaît pas. Et pourtant, tout est à sa portée pour diriger la création de cette nation malgré la réserve du tantae molis erat. Et je me réjouis de le dire en présence de l’homme dont j’ai dit qu’il était porteur de l’offre politique la plus innovante depuis Mpodol, Cabrl Libii li Ngué Ngué. À côté de ces deux sentences centrales, les mots clés de ce travail sont
Renaissance ; Acéphalisme ou système acéphale ; Système pyramidal.
Le Cameroun, comme toutes les anciennes colonies africaines est dans une période de son évolution qui correspond à la renaissance des vieilles nations européennes entreprise au 15 ème siècle. Il s’agit de faire des nations nouvelles avec des groupes, des tribus précoloniaux. Période paradoxale s’il en fut. En effet, l’exercice est complexe. La renaissance c’est, en s’appuyant sur son histoire et bien ancré sur le présent – sciences, technologie -, bâtir une nation, une identité nouvelles. L’exercice est d’autant plus complexe que les nations en création sont handicapées par des complexes en tout genre, par l’aliénation postcoloniale, par la pression malveillante de l’Occident et sa pensée dominante qui s’impose unique, freine très fortement l’émergence d’une pensée émancipée de la tutelle coloniale. En effet, l’Africain a admis la supériorité du Blanc et le prend pour modèle. Pourtant la pensée n’est pas universelle. Elle est spatio-temporelle, contextuelle. L’idée même de pensée unique que promeut l’Occident est une aberration. Il y a une pensée bassa, une pensée française, une pensée bamiléke ou italienne. Une pensée camerounaise est en chantier. Mais l’Africain continue à penser comme le Blanc voudrait qu’il pense. Ses références sont gréco-latines et occidentales en général. La langue qui en est le support est étrangère, un cheval de Troie introduit dans notre univers. Le cas camerounais est encore plus complexe. La diversité des espaces – la forêt, la savane, la montagne, la mer -, et des peuples qu’ils hébergent, la multiplicité des langues et des religions originelles et importées, tout cela fait de ce pays un laboratoire unique.
Afrique en miniature ! Je ne m’en réjouis pas comme mes compatriotes. De tout cela, il faut faire une nation. Complexité nationale, complexité BMB. En effet, un modèle social rarissime dans le monde, vient complexifier la renaissance du BMB. Ce peuple est acéphale, dans un contexte local et universel dominé par le modèle pyramidal. Voilà posée la dramaturgie du BMB isolé dans son nouvel univers. Comment sortir de cette culture mémorielle pour intégrer la nouvelle norme.
LE BMB UN PEUPLE ACÉPHALE
Je rappelle, et rappellerai encore : mon approche du modèle de gouvernance bassa- mpoo-bati – l’acéphalisme – n’est pas le fruit d’une recherche approfondie. C’est la compilation d’éléments épars, d’hypothèses qui me conduisent à certaines conclusions.
Qu’est-ce l’acéphalisme
Le lexique bassa est un indicateur de la vision de ce peuple, de sa position face à l’autorité temporelle. Le mot chef n’y existe pas. Le contact avec l’Occident a imposé un modèle social qui inclut l’autorité. Ceci a généré des termes qui désignent le pouvoir, transformation des mots étrangers. Le Kaasa qui dérive du kaiser allemand ; le kiñè, qui vient du king. On dit aussi nguilañ une déformation de grand qui accompagne souvent le mot chef, grand chef.
Le mot ordre, une injonction venant d’un pouvoir, d’une autorité, ce mot semble lui aussi absent du lexique bassa. Il ne peut pas y avoir d’ordre puisqu’il n’y a pas d’autorité temporelle pour en donner. Ici aussi, le bassa adapte le mot étranger. Order, anglais ou ordre français deviennent Oda en bassa.
Comment dit-on en BMB Accuser, dans le sens de trainer en justice ? Tout le monde dit Soman. Mais le mot soman bassa est un dérivé du summun anglais. Bien entendu, je ne suis pas péremptoire. Je ne sais pas si ma thèse, si mes hypothèses sont entièrement, partiellement ou pas du tout fondées. J’invite le BMB à cette recherche.
Le fils de la grotte ne connaît qu’une autorité, celle de son père. Il ne valorise qu’un espace, la tombe de son père, Soñ ‘ta, c’est-à-dire le lieu symbolique précis et restreint de son histoire immédiate. La tradition le dispense de la soumission à l’aînesse. A la mort du père, chaque enfant récupère sa part d’héritage et s’installe comme chef de la famille qu’il va fonder ou qu’il a déjà fondée. Bón boo bibum boo, neuf enfants, neuf parts d’héritage, dit l’adage.
Les origines de l’acéphalisme : possibles et probables
On pourrait penser que la générosité de la nature est pour quelque chose dans ce modèle. Le bassa-mpoo-bati n’était pas dans la nécessité de s’unir pour arracher les fruits à la terre, comme c’est le cas dans des zones ingrates. On trouvait tout dans la nature et assez facilement. Par exemple, personne ne plantait les arbres fruitiers. On jetait le noyau ou le pépin et on attendait sereinement la récolte qui arrivait très vite, vu la qualité du sol. Les anciens parmi nous n’ont pas oublié les bikodog, ces friches où l’on pouvait glaner des années durant, avec de belles récoltes à l’appui.
Pour la chasse, un porc-épic schizophrène, un hérisson neurasthénique, une antilope suicidaire, finissaient par se laisser pendre aux mauvais pièges oubliés d’un piètre chasseur. Les paresseux de type pangolin ou tortue, les autres reptiles comme le varan ou les serpents se laissent ramasser sans trop de résistance. Dans une nature aussi généreuse, chacun trouve son compte. Ensuite la force, l’adresse et l’ambition de l’individu vont départager les concitoyens. Tout le monde n’attendra pas le suicide du porc-épic. Tel citoyen habile à la chasse, tel autre invincible à la lutte, emportaient les suffrages dans leur art, étaient respectés et jalousés. Le bon danseur se rattrapait le moment venu et savourait à son tour son heure de gloire.
Le modèle économique était donc une agriculture minimaliste, la cueillette, la chasse et la pêche. Chaque famille pratiquait toutes ces activités pour son bien-être. Quelques rares castes assuraient des charges hautement pointues comme la santé, le travail des métaux et d’autres savoir-faire nécessitant une initiation particulière, que l’on nimbait alors d’un lourd nuage de mystère. Ces savoir-faire «scientifiques» n’étaient pas profanes, mais initiatiques, ésotériques. Leur transmission était sélective et directe. On les léguait à un membre de sa famille ou à une personne de son choix qui se devait de protéger jalousement ce legs. Il n’était pas rare que le parrain menace son poulain en lui disant que si d’aventure il divulguait le secret, son fantôme viendrait le persécuter ou même l’arracher à la vie.
L’hypothèse de l’acéphalisme lié à la générosité de la nature ne me satisfait pas. Pourquoi trouve-t-on un minimum de hiérarchie au sein d’autres peuples de la même forêt nourricière ? Alors que ces peuples ont le même espace socioéconomique que le bassa-mpoo-bati, les systèmes de gouvernance ne sont pas identiques. Le béti a le nkukuma dont il reconnaît l’autorité, le bizimbi qui assure le maintien de l’ordre. Le peuple Kongo de la même forêt équatoriale a connu de grands royaumes.
Le peuple des enfants de Dieu.
On peut admettre que certaines poches de sédentarisation des bassa-mpoo-bati tout au long des migrations depuis l’Egypte, ont adopté un système hiérarchisé. Cette évolution peut provenir de plusieurs facteurs : le désir de faire comme les peuples voisins ; la nécessité de faire face aux rigueurs du nouvel environnement ; parce qu’ils auraient été annexés. Le bassa du Cameroun garde l’originalité acéphale. Si j’en crois ce que m’en a dit Kofi Yamgnane, un bassar, branche bassa du Togo, il en est de même pour eux. On pourrait donc rechercher celle pratique dans l’histoire et dans la mythologie.
Le BMB revendique une ascendance égypto-pharaonique. Il se présente comme le fils du dieu soleil, bón ba Djob. Djob veut dire soleil, comme le dieu Râ de l’Égypte ancienne. On comprendra que le fils de Dieu ne puisse avoir d’autre maître que Dieu son père. Ce dieu c’est Hilolombi, le dieu unique, littéralement l’infiniment ancien, un primus inter pares. Le BMB est donc de la race des dieux, puisqu’il en est le fils. Jésus le fils de Dieu n’est-il pas Dieu lui-même, l’égal de Dieu !
Permettez-moi de vous raconter cette histoire qui tendrait à accréditer l’origine égyptienne du BMB et probablement de son acéphalisme. Kofi Yamgnane est un ami. Un jour, je lui ai demandé si le bassar connaît la notion de chef. Sans se donner le moindre temps de réflexion, il me répond que le bassar n’a pas de chef et que le mot pour désigner ce concept n’existe pas. Ils ont bien un référent qui assure le lien spirituel entre les membres du groupe et les ancêtres, en fait l’équivalent du mbombog. Puis il conclut : « La colonisation a divisé notre territoire en cantons et nous a imposé des chefs dits traditionnels ».
Nous poursuivons la conversation. Il me dit qu’il était allé chez son fils à San-Francisco. Un jour, ils reçoivent une publicité des tests ADN avec une remise de 50%. Ils se sont pris au jeu tous les quatre, son fils, sa belle-fille, son épouse et lui. Quelques jours après avoir envoyé leur salive dans des éprouvettes qui leur avaient été fournies, ils ont les résultats qui disaient que son fils et lui, étaient de l’ethnie bassa et qu’ils descendaient du pharaon Ramsès III.
En ces temps d’égyptologie forcenée, militante, je ne me suis jamais hasardé à émettre des hypothèses encore moins des thèses dans ce domaine. Mais j’ai toute latitude à exprimer mes émotions et mes intuitions « empiriques ». Ramsès III est né de Râ, le dieu égyptien du soleil. Les bassa ont pour Dieu Djob le soleil. Les bassa descendraient de Ramsès III selon les experts américains de l’ADN. Les bassa sont donc bon ba Djob, des enfants de Dieu, de Hilolombi, l’infiniment ancien. On peut fort logiquement imaginer que de génération en génération, ces dieux parce que enfants de Dieu, aient intégré l’acéphalisme, ne puissent accepter une autre autorité que le père qui est Dieu et son représentant sur terre qui est le géniteur.
Ajoutons cette autre observation. On dit que dans le monde, les peuples acéphales sont ceux qui ont de tout temps opposé le plus de résistance à l’oppression. En ce qui concerne les BMB, ils ont été les têtes de proue de notre guerre d’indépendance.
Les spécificités de l’acéphalisme.
Ce modèle d’organisation sociale a des avantages et des inconvénients. Il peut devenir un lourd handicap. Dans les nations en construction – et c’est le cas pour le Cameroun -, tous les groupes jadis autonomes doivent s’unir. Le bassa-mpoo-bati se retrouve avec des groupes au sein desquels la notion de hiérarchie et d’autorité est très forte. La norme universelle aujourd’hui est sur le modèle de société pyramidale. Le Cameroun comme les autres nations a un gouvernement. Les peuples du Nord et de l’Ouest du pays ont hérité de systèmes sociaux très hiérarchisés. Le pouvoir et ses tenants sont acceptés sans état d’âme. Ces peuples se sentiront donc à l’aise avec le modèle qui s’impose désormais à tout le monde.
Un peuple fier et en compétition permanente
Quoi qu’il en soit, cette singularité bassa-mpoo-bati a forgé à la longue un peuple fier. Ses membres sont en compétition permanente, puisque chacun se doit d’être le meilleur pour mériter le respect de tous. Généralement, la société ne vous dotait pas d’un statut héréditaire. Vous ne naissiez pas prince, noble ou roturier, d’une caste inférieure ou supérieure. Vous deveniez le meilleur par votre travail et tout le mode rêvait de vous détrôner, et vous jalousait donc.
Il y avait une autorité morale et spirituelle, le Mbombog. Cette espèce de sage, de shaman était garante de la cohésion du groupe et du lien avec les mondes invisibles. Jouissait-ils d’une autorité temporelle ! Certains veulent le croire. Mais cela me paraît improbable. Chaque clan avait son mbombog, m’a-t-on dit. Ici non plus, la transmission n’était pas héréditaire. Les mbombog de différents clans, m’a-t-on encore dit, pouvaient tisser des liens, appartenir à des confréries. Il serait intéressant de savoir à quel moment ces différentes confréries sont apparues dans l’organisation de ce groupe. Mais il est surtout essentiel de savoir, toujours aux dires de ceux qui en savent plus que moi, qu’un mbombog n’interférait pas dans la marche des affaires d’un autre clan.
Le mbombog existe toujours dans l’univers BMB. Mais aux propres dires de certains d’entre eux, ils n’ont pas échappé à la contamination des tares de la société, dont le lucre, les intrigues, encore moins aux bouleversements engendrés par la nécessité de subordination à un modèle national qui s’impose désormais à tous.
Dans le système bassa-mpoo-bati, il y a une contrainte latente, subliminale. On doit honorer la mémoire de son père. On se doit d’être le digne fils de…, le meilleur. Aucun pouvoir n’impose une dynamique de groupe. Mais l’on sait que l’on appartient à un groupe dont il faut être le plus performant. Tentons une comparaison. La démocratie est comme un sport en équipe et l’acéphalisme, un sport individuel. Dans une équipe, tous les athlètes participent au succès du groupe, chacun dans son rôle, sous la houlette d’un capitaine. Dans le système cher au BMB, chacun veut être le meilleur individuellement et participer ainsi au à l’éclat du groupe, mais sans capitaine. Les athlètes des sports individuels – acéphalisme – sont en compétition chez eux comme à l’extérieur. Les meilleurs représentent leur pays individuellement dans les rencontres internationales.
La compétition, l’absence de solidarité, l’individualisme, l’impunité
L’absence de hiérarchie, d’autorité, d’injonction, conduit à un sentiment d’impunité. Certes on parle de cette société secrète que les Mbombog chargeaient de punir les récalcitrants. Ceci ne se passerait pas après un jugement par un tribunal classique. Tout se passerait dans le mystère, l’occulte. Comme il n’y a pas de jugement, pas de sanction, pas de réparation, pas de justice temporelle, ceci a conduit à des pratiques de règlement de compte individuel. Chacun essayait de réparer selon ses moyens, ce qu’il considérait comme un tort envers lui. La « sorcellerie », les pratiques occultes, se sont développées à un haut point. On se protégeait, on protégeait les siens et ses biens. On observe par exemple l’usage du ndjeck, un fétiche que l’on place sur ses biens, les personnes sous son toit, ses bêtes et ses champs, qui frapperait tous ceux qui poseraient un acte répréhensible dans la zone protégée. On parle du nsoñ, un sort que l’on dit très efficace, que certains seraient capables de jeter à leurs ennemis. On peut aussi avoir recours à ces différents outils pour se venger.
Comme c’était prévisible dans un système aussi individualisé, la tradition, l’imaginaire ou peut-être la chronique sociale bassa-mpoo-bati font état de nombreux abus. Parce que l’on possède un pouvoir non contrôlé par un organe régulateur temporel, on peut faire le mal par jalousie. Puisque l’on est en compétition permanente, on fera du mal pour freiner l’évolution du cousin. On se transformera en éléphant, en porc-épic ou en hérisson pour dévaster les champs les plus prometteurs. On tuera le fils du cousin parce qu’il est très intelligent. Au bout du compte, toute mort devient suspecte. L’on pense aussi que c’est cette nécessité d’autodéfense qui a développé le goût de l’ésotérisme chez les bassa-mpoo-bati.
Après le mysticisme local, le BMB est devenu le meilleur client des ordres mystiques venus de l’étranger : occidentaux comme la franc-maçonnerie, les rose-croix et bien d’autres ; ou asiatiques comme le bouddhisme ou l’indouisme. Ils ont aussi fortement adhéré aux cultes étrangers. Si l’on n’est pas mbombog par la tradition, on le sera en devenant évêque, prêtre ou pasteur. Le premier évêque camerounais était un bassa. Le premier saint le sera probablement aussi. L’engouement du BMB pour les études découle aussi de cet esprit de compétition, mais surtout de ce désir d’acquérir un pouvoir qui met au dessus de l’autre.
LITTERATURE BASSA ET ACÉPHALISME: LES PROVERBES
Toute création se fonde sur deux préalables incontournables : le contexte et le prétexte. Pour inventer un parapluie, il faut qu’on soit en contexte pluvieux et que le prétexte soit la nécessité de se couvrir pour sortir. Si le contexte aquatique et la nécessité (prétexte) d’exploiter les eaux qui a conduit à la conception des embarcations.
La création littéraire se fait avec les mêmes fondements. Le contexte étant un groupe précis, u !n environnement déterminé, le prétexte, le besoin de formation, d’information, de moralisation, de création esthétique. On ne peut pas analyser la création littéraire bassa que sont les proverbes sans tenir compte de la spécificité de ce peuple, sans tenir compte de son individualisme forcené de l’absence logique de solidarité, et de la compétition acharnée. On ne saurait dissocier l’analyse de cette littérature du système social acéphale. Quelques illustrations.
Hiki mut a keynèguè bot i ntel wé. Chacun doit accrocher son sac selon sa taille. On rencontre ici la nécessité bassa de se suffire à soi-même. Un autre peuple aurait suggéré d’avoir recours à son frère plus grand pour accrocher son sac hors de portée d’éléments nuisibles. On aurait pu demander de procéder à la technique de la courte échelle. Mais l bassa de se suffire à lui-même.
Bon bo, bibum bo : Neuf enfants, neuf héritages. La mort du père sonne la distribution de l’héritage et comme la fin de la cohésion familiale : plus de droit d’aînesse. Chacun gère son héritage à sa guise, fonde une famille dont il est le chef.
Wò wada u nkañ be djomb : une main n’attache pas un paquet (on ne fait pas un nœud avec une main). On pourrait penser à une injonction pour la solidarité. Mais il s’agit tout simplement (dans le contexte bassa) d’une leçon de bon sens. «Ne fait pas le mali ou l’idiot. Sers toi de tes deux mains pour faire un nœud).
Gwelna gwelna bilèñ bi nyol : Nous nous tenons comme les lattes de la toiture. Dans ce proverbe, l’on n’exprime que la chute du texte. La connaissance du proverbe dans son intégralité écarte toute idée de solidarité. Il s’agit plutôt d’une neutralisation mutuelle. Nous sommes en présence de la dialectique du prisonnier et du geôlier. Un pasteur qui a perdu son jeune fils interpelle Dieu. « Ne nous fais donc pas ces choses parce que tu nous aurais créé. Tu nous tiens et nous te tenons, comme les lattes de la toiture ». Si le vent survient, il nous emportera tous.
Tolo a ta bé nlimil u ndjock : La souris n’est pas le souffre-douleur de l’éléphant. Le bassa ne reconnaît la supériorité de personne sous aucun prétexte.
Ndi a nhañ bé i hob u bassa : Pas de discours bassa sans la conjonction MAIS. Si le proverbe ci-dessus n’était pas assez clair, avec celui-ci, le doute n’est plus permis. Le bassa doit s’opposer à tous, à tout prix, en toute occasion. Puisque la souris n’est pas le souffre douleur de l’éléphant, puisque chacun doit être meilleur, on ne peut pas reconnaître le mérite, la supériorité de l’autre. Le défi, l’opposition sont systématiques. Les anecdotes qui suivent vont nous démontrer à quel point cette mentalité est enracinée dans la culture mémorielle bassa.
A Hogbè Nlend, unu nsongui u kwoò wò
Le dirigeant politique – et accessoirement génie mathématique – Henri Hogbè Nlend tenait un meeting dans le quartier modeste de la Cité Sic à Douala. Une dame l’a interrompu en ces termes. « Monsieur Hogbè Nlend, je me suis laissé dire que tu étais bon en calcul. Mais ce calcul, tu l’as raté ». La dame aurait pu défier Hogbè Nlend en tout. Elle aurait pu lui dire qu’il était intelligent mais qu’il manquait de sagesse. Elle aurait pu douter de ses capacités en politique, blâmer son propos de toutes les manières. Mais elle l’a défié dans le champ où il est l’un des meilleurs au monde.
A Ngidjol, mè beb wè i dictée. (Nguidjol, je suis meilleur que toi en dictée)
Dans la même veine, on m’a rapporté que l’agrégé de grammaire Pierre Ngidjol allait comme beaucoup de bassa de toutes les catégories sociales dans un coin de Mvog Ada réputé pour ses parties de Ludo, ce jeu jadis très populaire au Cameroun. Un jourquelqu’un lui a dit que l’on prétendait qu’il était bon en français, qu’il le défiait en dictée et était sûr de le battre.
Et cerise sur le gâteau de ce chapitre, dans notre quartier de New-Bell bassa à Douala, il était courant d’entendre des adolescents, en voyant leur aînées en discussion, décider d’aller mettre en doute tout ce qu’ils allaient dire. « Di kè di péna bi grands bi » (Allonsmettre en doute tout ce que diront ces aînés). Ici, l’aînesse est bafouée et la controverse systématique magnifiée.
LES INDICATEURS DE LA RENAISSANCE
Le mouvement associatif bassa s’inscrit généralement sur une logique clanique. L’on se réunit sous la bannière du Log comme on désigne les clans bassa-mpoo-bati. Le peuple bassa y adhèrera massivement. Comme tout peuple acéphale, il est rebelle à toute autorité. Dans une approche renaissance postcoloniale, l’unité des bassa-mpoo-bati comme groupe, prend forme avec l’avènement de l’UPC porté par l’un des leurs, Mpodol Ruben Um Nyobè. L’aventure de l’immortel de Boumnyebel semble n’avoir apporté aucun fruit à son peuple. J’y situe néanmoins les débuts de la pensée nouvelle de ce peuple. Peu après, avec la belle aventure du club de football Dynamo de Douala, on ressuscite une prophétie que l’on prête à Mpodol selon laquelle l’unité des bassa viendrait d’un « jeu».
Le club des Enfants de Dieu – bon ba Djob, le slogan est à son apogée – va soulever beaucoup d’espoir, mais ce n’est pas encore la terre promise. Il est néanmoins intéressant de constater que la première association généraliste bassa est créée par rapport à Dynamo.
Nous sommes dans les années 1980. Des jeunes bassa de la ville de Douala, qui se retrouvent souvent pour aller voir les matchs de leur club préféré, formalisent leur regroupement en une structure associative dénommée Amicale 5 qui deviendra plus tard la toujours active Amicale 9. Plus tard, encore, l’association Mbog liaa qui voit le jour dans les années 1980 apparaîtra comme une émanation de l’Amicale 9. Aujourd’hui, le vent est à la logique revendication d’une région bassa dénommée la Grande Sanaga. Une kyrielle de forums qui souvent évoluent en structure associative a vu et continue à voir le jour.
On y retrouve tous les thèmes, en particulier ceux sur lesquels les BMB reconnaissent leurs limites. La solidarité est le premier et c’est elle qui encadre les structures qui se voudraient économiques, entrepreneuriales. La diaspora n’est pas en reste. On retrouve ses membres dans tous ces forums. Elle en crée. Mais elle a réussi la plus belle performance du mouvement associatif bassa et peut-être camerounais avec Ndab Bikokko et ses presque quatre mille membres disséminés dans tout l ‘hémisphère nord. Même le Likoda qui regroupe les natifs de New-Bell bassa (Douala) est fortement animé par cette diaspora.
Que de chemin parcouru
Nous le redisons, la création s’inscrit dans un cotexte et un sous un prétexte. Le contexte acéphale bassa va induire des comportements et des créations conformes à ce contexte. Quand une affirmation, tout en tenant compte de ce qui précède pourrait prêter àconfusion, la sagesse éclaire le créateur pour qu’il lève toute équivoque. En voici un exemple.
Djam li mut u tèhè u kal : Il faut dire le fait de l’autre. Serait-ce un appel à la dénonciation ou pire, à la délation. Un autre proverbe va venir clarifier les choses. Djam li mut, bo laa, wè nhiii : Si on t’interroge sur Le fait d’autrui, tu dis que tu n’en sais rien. On comprend donc que le fait d’autrui dont il faut parler, c’est le fait positif.